Beaulieu-en-Rouergue, Najac
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue, Église Saint-Jean l’Évangéliste et Forteresse Royale de Najac.
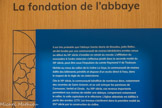
1

2
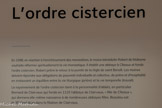
3
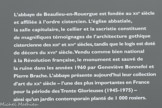
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42
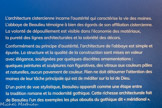
43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66
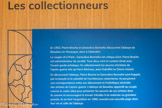
67

68

69
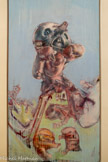
70
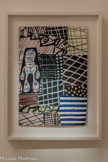
71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83
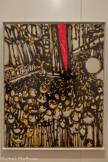
84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98
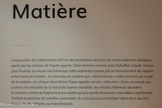
99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114
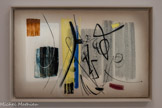
115

116

117

118

119

120

121
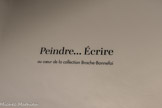
122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140
